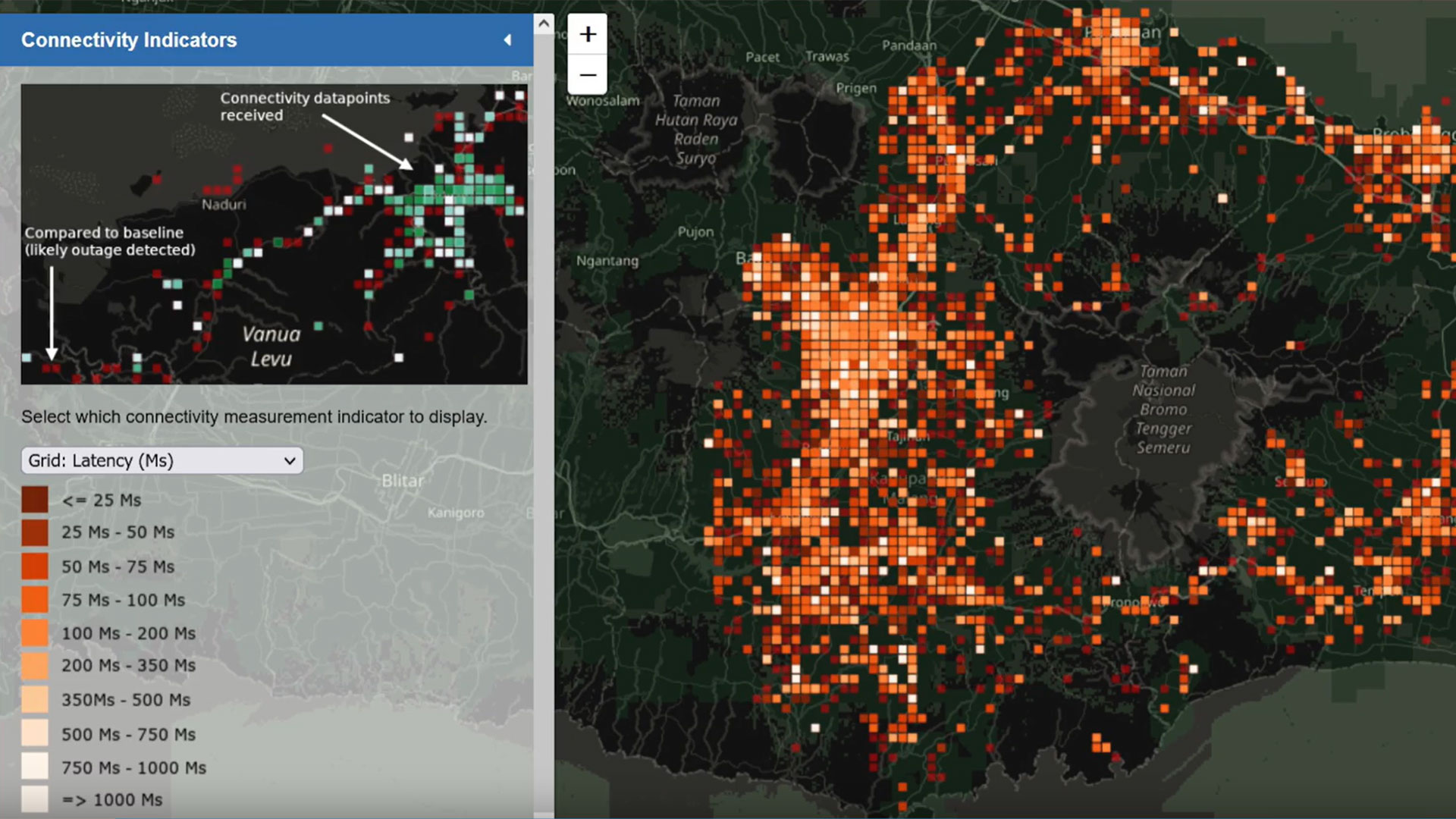La transition verte et le numérique
En 2025, l’Union internationale des télécommunications fête ses 160 ans d'existence.
Cet article sur la transition verte du secteur du numérique fait partie d'une série publiée par le Service de la Genève internationale qui aborde la contribution de l'UIT aux grands défis mondiaux, , au sein d'une ville forte d'une longue tradition de coopération multilatérale.
Depuis longtemps on nous rappelle que s’abstenir d’imprimer et privilégier le numérique permet de sauver des arbres. Les technologies numériques boostent la productivité tout en réduisant l’empreinte carbone et la production de déchets, par exemple grâce à des systèmes qui gèrent intelligemment l’utilisation d'énergie dans les bâtiments ou l’eau pour irriguer les champs.
Les solutions numériques permettent également d'accélérer les progrès dans des domaines aussi variés que l'éducation, la réduction de la faim et de la pauvreté, et l'action pour le climat.
Mais le numérique a également une face plus sombre.
Pendant longtemps, on n'a pas fait le lien entre technologie numérique et impact écologique, passant sous silence la quantité d’électricité et d’eau consommée par les centres de données pour faire tourner et refroidir leurs serveurs, sans parler des déchets électroniques qu’ils produisent. Même aujourd'hui, à l'ère des systèmes de transport intelligents, des grands modèles de langage, de la blockchain et des vidéos qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, nous n’avons pas pleinement conscience des compromis environnementaux qu’implique notre utilisation de ces technologies.
Les experts commencent tout juste à explorer le potentiel des partenariats pour réduire les émissions et les déchets générés par le secteur du numérique.
Le défi vert de l’intelligence artificielle
Aujourd’hui, le secteur du numérique génère environ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 62 milliards de kilos de déchets électroniques chaque année. Ces chiffres sont en rapide augmentation : la puissance de calcul de l'intelligence artificielle double tous les 100 jours alors que sa consommation énergétique augmente de 26 % à 36 % par an.
Greening Digital Companies 2024, un rapport de l'UIT et du Word Benchmarking Alliance, évalue l'impact environnemental des 200 plus grandes entreprises du secteur. Le rapport détaille leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre, ainsi que leurs objectifs environnementaux, leurs engagements et leur degré de transparence. Il comprend également des recommandations sur les politiques publiques à adopter pour inciter les entreprises à réduire l'empreinte carbone de leurs chaînes de valeur, par exemple en restructurant le marché de l'énergie, en modernisant les réseaux électriques ou en investissant dans les énergies renouvelables.
Collaborer pour réduire notre empreinte carbone
À travers son initiative Green Digital Action, l'UIT encourage les entreprises à s'engager à adopter des solutions évolutives et à en assurer collectivement le suivi. Sans un suivi rigoureux des émissions et des déchets, le secteur ne dispose pas des données nécessaires pour orienter ses décisions.
Les grandes entreprises ont un rôle décisif à jouer dans la réduction des émissions et des déchets. Les principaux acteurs du numérique se sont déjà engagés à adopter des objectifs basés sur la science et à communiquer leurs données à l'UIT chaque année.
La Déclaration de la COP29 sur l'action numérique verte est soutenue par 82 États et environ 2 000 entreprises, universités et associations faîtières. Cette déclaration aborde la résilience des infrastructures numériques, la gestion des déchets électroniques, les mesures de soutien pour renforcer l'accès des jeunes et des femmes au numérique, la prévention des catastrophes, la réglementation, les solutions vertes, le financement de l'innovation et la consommation durable.
Dans la perspective de la COP30, qui aura lieu en novembre 2025, l'UIT encourage les entreprises et les États à intégrer le numérique durable à leurs engagements climatiques (contributions nationales dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015) et à leurs plans nationaux.
Pendant ce temps, plusieurs organisations internationales à Genève s’efforcent de réduire l'impact écologique de l'intelligence artificielle en développant des normes relatives à l’efficacité énergétique, à la gestion des déchets électroniques et à la réduction des émissions, sous l'égide de la Coopération mondiale en matière de normalisation. Cet organisme réunit la Commission électrotechnique internationale, l'Organisation internationale de normalisation et l'UIT.
La Digital Impact Alliance (qui fait partie de Green Digital Action) a présenté ses recommandations à la COP29 dans un rapport qui fait date. L'initiative Green Digital Action comprend un groupe de travail sur l'informatique verte qui se penche sur la question de l'intelligence artificielle et des centres de données. Le concours « Innovation Factory » de l'UIT récompense les start-ups qui développent des solutions d'intelligence artificielle pour soutenir l'action climatique.
Les jeunes veulent prendre le relais d'une intelligence artificielle plus verte
Plus de 55 % de la population mondiale a moins de 35 ans. Ces jeunes ont grandi avec le numérique et s'en serviront toute leur vie. Plus de 70% d'entre eux aimeraient voir une action plus forte en faveur du climat.
Il va de soi qu'ils veulent aussi réduire l'empreinte carbone des technologies numériques. Ce message a été réitéré lors du dernier Global Youth Summit en mars 2025.
La sauvegarde de notre planète est une véritable course de fond. Les jeunes demandent aux dirigeants d'aujourd'hui de leur passer le relais – vert, si possible. Ce sont surtout les entreprises du secteur du numérique qui doivent agir rapidement.
Verdir l'intelligence artificielle : cerveaux, superordinateurs et compromisProspérité ou planète ? La Neue Zürcher Zeitung (NZZ), quotidien suisse de référence, pose le débat dans un article sur les dernières tendances pour réduire le bilan énergétique de l'intelligence artificielle. Actuellement, l'intelligence artificielle fonctionne majoritairement au moyen de microprocesseurs de type GPU (graphic processus unit), conçus à l'origine pour accélérer la création d'images pour les jeux vidéo. L'intelligence artificielle exploite la rapidité de calcul de ces puces ainsi que des logiciels spécialisés. Mais les puces GPU sont très gourmandes en énergie. Pour entraîner et alimenter une intelligence artificielle il faut des centres de données de plus en plus grands, qui peuvent engloutir autant d'électricité qu'une petite ville, selon la NZZ, ou l’équivalent de 100 000 ménages. Dans le cas des immenses centres de données actuellement en construction, ce chiffre serait multiplié par 20, selon l'Agence internationale de l'énergie. Pourtant, une alternative moins énergivore est actuellement en développement : les puces dites « neuromorphes ». Le cerveau humain consomme très peu d'énergie – l’équivalent d’une ampoule – pour effectuer des calculs complexes, grâce à une utilisation efficace du réseau neuronal. Ces puces sont intégrées à des ordinateurs neuromorphes, qui fonctionnent sur le même principe que le cerveau humain : les neurones artificiels ne s'allument que lorsqu'ils reçoivent une donnée. Ces ordinateurs d'un genre nouveau, d’une grande efficacité énergétique, ont été testés avec succès dans la logistique des transports et la recherche pharmaceutique. Pour le moment, ils ne sont pas encore assez rapides pour servir à l'entraînement des grands modèles de langage. Mais les chercheurs expérimentent actuellement des techniques qui permettraient de traiter des demandes en sollicitant seulement une petite partie d’une d’intelligence artificielle afin d'en améliorer la réactivité. L’utilisation à grande échelle d’ordinateurs neuromorphes serait un énorme pas en avant pour le secteur du numérique. Mais pour cela, il faudrait que les entreprises aient la volonté de changer un système qui marche. Face à l’augmentation exponentielle des besoins en énergie de l'intelligence artificielle, l’inaction n’est déjà plus une option. |
Pour en savoir plus sur l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle rendez-vous à AI for GoodVous cherchez des nouvelles idées ou des partenaires pour réduire l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle ? Rejoignez l'atelier d'un jour organisé par l'UIT dans le cadre du Sommet AI for Good, intitulé Navigating the intersect of AI, environment and energy for a sustainable future (10 juillet 2025 à Palexpo). Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur la consommation en énergie et en eau de l’intelligence artificielle, le cycle de vie des matériaux utilisés dans les systèmes informatiques, ainsi que les dernières innovations pour freiner la croissance de l’empreinte carbone de cette technologie. On parlera entre autres de puces, d’architecture et d’algorithmes plus efficaces, d’énergies renouvelables et de centres de données plus durables. La question des normes, des politiques et des réglementations dans le domaine de l’intelligence artificielle sera également abordée, ainsi que les mesures à prendre pour réduire les émissions générées par le secteur du numérique |